Litté-rature – « Ni d'Ève ni d'Adam » d'Amélie Nothomb


En 2014, je vis un beau jour à la télévision la bande-annonce, d'un film, Tokyo Fiancée, qui se passait au Japon et semblait raconter une histoire d'amour entre une européenne professeure de français et un japonais. Il s'agissait en fait d'une adaptation d'un livre d'Amélie Nothomb intitulé Ni d'Ève ni d'Adam et paru en 2007. Ayant à cette époque une certaine fascination pour le Japon, et n'ayant encore jamais lu aucun roman d'Amélie Nothomb, je me procurai quelques jours plus tard l'ouvrage et commençai à le dévorer.
Malgré ce biais positif, après une centaine de pages, je commençais à me rendre compte que quelque chose me chiffonnait avec la manière dont le livre était écrit... Ma suspension consentie de l'incrédulité s'était envolée, et il m'était maintenant impossible de la récupérer : fronçant les sourcils, je commençais à analyser plus précisément ce qui me dérangeait dans l'écriture. C'est alors que j'eus une révélation : le bouquin que je tenais entre les mains était une vraie compilation d'erreurs stylistiques qui mériterait d'être étudié par tout aspirant écrivain !
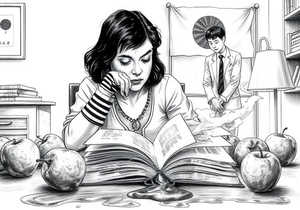
Dans cet article, je souhaiterais donc vous présenter divers angles d'analyses du roman Ni d'Ève ni d'Adam d'Amélie Nothomb m'ayant amené à cette conclusion.
Avant de commencer je souligne que je séparerai nettement l'autrice Amélie Nothomb, d'Amélie le personnage de fiction du roman, pour des raisons qui seront développées ci-dessous. À chaque fois que j'écrirai « Amélie », je me réfererai donc par défaut au personnage du roman, et pour éviter toute confusion, j'écrirai « Mme Nothomb » lorsque je souhaiterai renvoyer à l'autrice.
Concernant le contexte, je précise que je n'ai lu aucun autre roman d'Amélie Nothomb, et que je n'ai par conséquent absolument aucune idée d'à quel point mes analyses stylistiques sont généralisables à ses autres récits. Je connais par ailleurs très peu la personnalité médiatique d'Amélie Nothomb, mon seul souvenir d'elle datant d'il y a 10 ans, pour l'avoir vue sur un plateau de télévision « dégustant » des fruits avariés. Mis à part quelques conclusions clairement signalées, mon analyse ne se base donc que sur des éléments tirés du roman lui-même.
N.B. L'analyse actuelle couvre environ la première moitié du roman. Je compléterai prochainement cet article avec des éléments issus de la seconde partie.
Enfin, je rappelle à tout hasard qu'il s'agit uniquement d'une critique littéraire d'un roman en particulier et en aucun cas d'une attaque personnelle envers l'autrice ni envers l'ensemble de son œuvre.
Le premier sujet que je souhaiterais aborder est la présence dans le roman de nombreux épisodes qui m'ont interpellé par leurs aspects particulièrement péjoratifs.
L'épisode d'Amy Le premier qui amorce cette tendance dans le roman, est celui durant lequel Amélie rencontre une américaine, Amy, et se met immédiatement à la haïr :
Il y avait là [...] une jeune Américaine appelée Amy. Sa présence nous força à parler anglais, ce qui me la rendit odieuse.(p.24)
[...] je me laissai donc aller à une exécration naturelle.(p.25)
Là où cela devient dérangeant, c'est lorsque suit la description de la manière puérile et mesquine dont Amélie se venge, et cela simplement au motif que son interlocutrice lui ait appris le sens du mot asubo :
J'enrageai que ce fût une ressortissante de Portland qui me l'apprenne et, aussitôt, me lançai dans la pédanterie afin de la remettre à sa place [...] je comparai otium avec le grec ancien, ne lui épargnant aucune étymologie indo-européenne. Elle allait voir ce qu'était une philologue, la native de Portland. Quand je lui eus bien fait rendre gorge [...](pp. 26-27)
Je trouve qu'il y a une certaine disproportion dans les expressions employées (faire rendre gorge
) et la situation en question. Amélie (le personnage de fiction), semble d'emblée avoir un énorme égo, être très susceptible, et la pédanterie est pour elle un outil de vengeance.
Les grand-parents de Rinri Cette tendance dépréciative se confirme à nouveau lorsque Amélie se rend pour la première fois dans la maison de Rinri1 . Là-bas elle y rencontre non seulement ses parents, mais également ses grand-parents. Voici sa réaction :
Je songeai qu'ils devaient souffrir de sénilité et que ces gens étaient admirables de garder chez eux ces débris mabouls.(p.35)
Les horribles vieillards finirent par obtempérer [...](p.36)
Ses grand-parents paternels n'étaient plus, nouvelle qui me soulagea : il n'y avait donc que deux monstres dans cette sphère.(p.39)
Là encore, on a du mal à comprendre pourquoi les deux grand-parents sont qualifiés si durement de débris mabouls
. La moindre broutille étant d'ailleurs dramatiquement amplifiée : Mais la nuit, je fus assaillie de cauchemars dans lesquels les aïeux de Rinri me tiraient les cheveux et me pinçaient les joues en croassant de rire.
(p.36). Un antagonisme qui continuera :
Les grand-parents m'appelèrent plus que jamais Sensei, ce qui confirma leur perversité.(p.87)
Vu le dégoût que m'inspiraient ses aïeux, j'acceptai avec soulagement de dormir dans le lit de ses parents.(p.130)
L'épisode du peintre Plus tard, amélie assiste au vernissage d'un peintre et le trouve, à l'instar d'Amy, odieux
:
Il toisait alors avec mépris ces êtres qu'il considérait sans doute comme un mal nécessaire. [...] – Il n'y a rien à comprendre, rien à expliquer, répondit-il avec dégoût. Il y a à ressentir. – Précisément je ne ressens rien. – Tant pis pour vous. [...] Après coup, il me sembla que son discours était cohérent. [...] Indépendamment même de l'argent, comme il doit être beau, pour un créateur, de voir son œuvre considérée avec une telle attention ! pp.44-45
Amélie adhère-t-elle finalement à l'attitude du peintre ? Le fait qu'elle adhère finalement à son discours est équivoque. Par ailleurs, s'exprime ici l'envie d'Amélie de recevoir l'admiration des autres.
Ce sous-texte laisse particulièrement dubitatif si l'on établit un pont avec Mme Nothomb, l'écrivaine. Toise-t-elle elle aussi avec mépris ces fans, qu'elle considère comme un mal nécessaire ? Vis-à-vis de son lectorat, je trouve bien étrange de relater cet épisode sous cet angle dans un roman qui se prétend autobiographique.
Une certaine xénophobie ? Nous avons déjà évoqué l'américaine Amy pour qui Amélie ressent une exécration naturelle. Plus tard, nous retrouvons la même condescendance vis-à-vis d'un GI américain, où l'on notera encore une fois la dureté du propos lié à la famille.
Il ne méritait pas d'appartenir à la lignée : il était bavard et indifférent au sacré. Toutes les familles comportent ce genre d'erreur héréditaire.(p.119)
La nationalité américaine n'est d'ailleurs pas la seule à pâtir d'un vocabulaire péjoratif dans le roman :
Il y eut même un Italien, mais il ne tarda pas à jeter l'éponge, incapable qu'il était d'omettre l'accent tonique.(p.31)
J'en vins à regretter la présence des allemands, sans lequels j'eusse pu alléguer n'importe quoi [...](p.48)
N'y aurait-il pas un fond de xénophobie chez Amélie ?
↑Pour créer, rien de tel que le matériel bas de gamme, voire de rebut. p.133
La seconde thématique que je souhaiterais aborder est celle de la banalité de la majorité des éléments du récit. En lisant ce roman, il m'a souvent semblé que Mme Nothomb n'avait pas grand-chose à raconter à propos de la trame principale, comme si elle manquait de matériel narratif. Le roman est ainsi brodé de divagations autour d'épisodes anodins du quotidien d'Amélie dont on a souvent du mal à comprendre le lien avec l'histoire et la raison de leur survenance.
Cela se traduit notamment par une héroïne qui semble complètement déconnectée de la réalité, phantasmant sa vie et donnant une signification démesurée à chaque petit évènement de la journée.
Malheureusement mettre des formes sur un contenu creux ne dissimule pas le manque de fond, mais au contraire l'accentue, ce qui donne l'impression d'un roman ayant été artificiellement enflé. C'est dommage puisque de mon point de vue, la décision d'écrire devrait se baser sur la réflexion suivante : « Qu'ai-je d'intéressant, d'original à raconter ? ».
L'épisode de la « maîtresse » Un premier exemple nous est offert au tout début du roman où démarre un quiproquo banal de quelques pages : Rinri présente Amélie à ses amis comme étant sa « maîtresse », ce qui semble mettre mal à l'aise Amélie du fait que « maîtresse » puisse signifier « amante ». L'erreur est pourtant compréhensible puisqu'on dit, notamment à la maternelle, la maîtresse d'école, et que Rinri est en plein apprentissage de la langue française.
Pourtant plutôt que de clarifier la situation, Amélie simule l'indifférence (p.18) et a des réflexions très imaginatives :
À cause de ce malentendu, et de peur de paraître une dominatrice en amour, je n'osai plus donner de consignes à mon élève(p.18).
L'attitude de Christine me crispait, sans que je sois assez intime avec elle pour lui expliquer la vérité.(p.19)
L'escalade hâtive entre une ambiguïté sur le mot « maîtresse » et le fait de paraître une dominatrice en amour laisse perplexe, surtout qu'à ce stade la relation entre Amélie et Rinri est purement professionnelle. Par ailleurs, faut-il vraiment être intime avec quelqu'un afin de dissiper une telle confusion ?
Cet épisode est une préfiguration éloquente de qui nous attend dans le roman, et ce à deux niveaux. Tout d'abord, il contient les prémisses des tempêtes dans une tasse de thé, où, la narration ne semblant pas se suffire à elle-même, des platitudes sont montées en épingle. Ensuite, il annonce des aspects importants de la personnalité d'Amélie, comme la fabulation, la passivité et la retenue des émotions.
L'épisode de l'okonomiyaki et autres galéjades Toujours au commencement du roman, Amélie est invitée à un repas où elle mange de l'okonomiyaki, plat qui lui rappelle son enfance :
[...] cette cuisine populaire si atrocement émouvante.(p.28)
Je ratiboisai mon okonomiyaki, les yeux dans le vague, en poussant des râles de volupté.(p.28)
[...] une aventure de la mémoire d'une profondeur si bouleversante qu'il ne fallait pas espérer la partager.(p.29)
On voit ici comment un souper prend rapidement les dimensions d'une expérience transcendante2, et l'on relèvera également l'usage du verbe « ratiboiser », présage d'un certain mauvais goût dans les descriptions. Ce procédé d'exorbitance de mondanités est employé à plusieurs reprises dans le roman :
des concerts à l'aide de signaux de l'électroménager(p.54).
polystyrène devait être en train de s'expanser encore dans mon cerveau, qui synthétisait cette excroissance sous la forme d'un délire d'expérimentation(p.58), phrase qui n'a au passage aucun sens.
À d'autres moments, ce sont les objets qui deviennent baroques afin d'enjoliver la réalité. La maison des parents de Rinri devient ainsi une base intersidérale
(p.33). Durant la fondue, le réchaud se meut en un réchaud à propulsion intergalactique
, le fromage en polystyrène expansé
et le vin blanc en antigel
(p.56). Tandis qu'une baignoire parce qu'elle a la dimension d'une baleine creuse
se transforme en bain-baleine
(pp.82-83). Pratique pour raconter tout et n'importe quoi :
Il versa le polystyrène et l'antigel dans le caquelon, alluma le réchaud qui, curieusement, ne décolla pas vers le ciel [...](p.56)
L'épisode de la fondue Attardons-nous maintenant sur cette séquence, particulièrement marquante de par son incongruité, dans laquelle Rinri se rend chez Amélie avec une valise à fondue. C'est lorsque les deux ont fini de manger qu'Amélie a alors l'idée saugrenue de mettre ses mains dans la fondue...
[...] j'éteignis le réchaud en soufflant dessus, [...], vidai le reste de l'antigel dans le mélange pour le refroidir et plongeai mes deux mains dans cette glu. [...] Je retirai mes pattes et m'amusai de l'écheveau de fils qui les reliait désormais. Une épaisse couche de faux fromage les gantait. pp.58-59
Comme si la scène n'était pas déjà assez ridicule, Amélie décide ensuite de se peler les mains avec un couteau de cuisine... jusqu'à ce que Rinri s'agenouilla et saisit l'une de mes mains qu'il commença à racler avec ses dents.
(p.59). On nage ici en plein délire grotesque et peu ragoûtant, un sommet d'ineptie au sein du roman.

J'étais donc très curieux de voir comment cette scène particulièrement gênante du livre allait être traitée dans le film, et malgré ce que nous dit l'actrice Pauline Étienne dans un jeu sans grande conviction, ce n'est ni drôle, ni beau, c'est tout simplement malaisant.
L'épisode de la dinde Un autre passage qui transpire d'insipidité de propos est celui où Amélie ergote à propos du rôle des gens maigres dans sa vie.
Si j'examine mon passé, je remarque que cent pour cent des êtres qui ont joué dans ma vie un rôle important étaient maigres. Si ce n'était évidemment pas leur caractéristique principale, c'est le seul point commun qui les relie. Cela doit vouloir dire quelque chose. Certes, j'ai croisé sur ma route bien des maigreurs qui n'ont pas changé le cours de mon destin. J'ai d'ailleurs vécu au Bangladesh où la majorité de la population est squelettique [...] p.107
Cette obsession d'Amélie de vouloir se convaincre que des détails sans importance sont significatifs fait rouler des yeux. Ici encore, plutôt que de développer le récit, on part sur des réflexions niaises avant de dérailler dans une disgression sur le Bangladesh sans queue ni tête. Et pour terminer un beauté, un autre extrait qui tombe comme un cheveu dans la soupe, celui de la « dinde » :
Il y a deux ans, une jeune dinde dont je tairai l'identité vint s'offrir à moi, à un titre que je préfère ignorer. Voyant ma consternation, la dindonne pivota devant moi afin de mettre en valeur sa sveltesse et déclara, je le jure : – Vous ne trouvez pas que je ressemble à l'une de vos héroïnes ? p.108
Épisode non seulement sans rapport avec le récit et dont on se fiche royalement, mais qui est en plus de très mauvais goût, entre relents grossophobes, sous-entendus sexuels, et vengeance mesquine dans la lignée de l'écriture toxique que j'ai déjà évoquée précédemment. C'est précisément à la lecture de ce passage que j'ai compris que quelque chose clochait vraiment dans le style du roman.
La banalité de Rinri La quatrième de couverture nous annonce fièrement : Ni d'Ève ni d'Adam révélera qu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyoïte très singulier
. Nous pourrions donc nous attendre à ce que le roman nous explique en quoi consiste la singularité de Rinri.
On apprend donc que Rinri aime parler d'amour, contrairement aux autres Japonais, et qu'il a voyagé seul :
Il avait fallu que je tombe sur le seul Nippon qui ne dédaignait ni ce vocabulaire, ni les manières ad hoc.(p.75)
Il n'était pas le Japonais type. Ainsi, il avait énormément voyagé, mais seul et sans appareil photo.(p.84)
C'est un peu léger... Alors oui, il existe bien une particularité réelle de Rinri : le fait que celui-ci veuille devenir Templier suite à sa lecture d'un livre sur les chevaliers de l'ordre du Temple (pp.109-110). Mais cela semble plutôt être une lubie passagère qu'un réel trait particulier.
En fait, Rinri symbolise justement pour moi le jeune Japonais issu d'une famille aisée tout ce qu'il y a de plus standard. Au fond, il ne tient dans le roman qu'un rôle de tapisserie et on pourrait aisément l'interchanger avec n'importe quel autre nippon d'une classe sociale similaire sans que le récit n'en soit affecté.
En conséquence, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à raconter sur Rinri, Mme Nothomb utilise son sempiternel stratagème du potager : inventer des salades.
Comme il circulait à travers Tokyo, je me demandai si le métier de son père ne dissimulait pas son appartenance à la Yakusa dont c'était le véhicule type [une Mercedes].(p.22)
Peut-être mon pressentiment au sujet de son appartenance à la Yakusa se justifiait-il. [...] Cette nuque si parfaitement rasée, quelle allégeance signifiait-elle ?(p.32)
Une estampe de clichés sur le Japon ? De fil en aiguille, on en arrive à se demander si la banalité de Rinri ne fait pas tout simplement écho à la vitrine stéréotypée que nous livre Amélie du Japon : les Japonais sont hyper polis et respectueux, les Japonais sont obsédés par la technologie et les gadgets, le système scolaire japonais est difficile (pp.68-70), les riches joailliers appartiennent à la mafia Yakusa, les baleines sont en voie de disparition (pp.83-84).
Que ce soit au niveau des spécialités culinaires japonaises (okonomiyaki, sauce d'Hiroshima, kori, sushis et sashimis), des lieux touristiques (Hakone et les tori, le Parc des jeux Olympiques, Hiroshima, le Mont Fuji), ou encore des références culturelles (roman et film Hiroshima mon Amour, carpe koï), le roman donne l'impression d'avoir été généré à partir d'une brochure de voyage à destination des Occidentaux. N'ayant moi-même jamais mis les pieds au Japon, le livre ne fait que confirmer toutes mes idées reçues sans jamais me surprendre.
On notera à ce propos que la banalisation du bombardement d'Hiroshima de la bouche même de Rinri est choquante :
– Et puis, survoler Hiroshima, ça doit donner l'impression d'être à bord de l'Enola Gay dit-il.(p.101)
Quelle bourde ! Je ne sais pas si Mme Nothomb se rend compte de ce qu'elle écrit mais j'ai vraiment du mal à m'imaginer qu'un Japonais ait envie de savoir ce que cela fait d'être à bord de l'avion qui a dévasté son pays avec une ogive nucléaire...
Du coq à l'âne Parmi les autres exemples de disgressions étranges, le choix de titre du roman, qui laisse dubitatif :
Avec mes six mille yens, au supermarché, je pouvais acheter six pommes jaunes. Adam devait bien cela à Ève.(p.15)
En contexte, Amélie vient de rencontrer pour la première fois Rinri en vue de lui donner des cours de français. Rinri paie la « leçon » six mille yens, mais Amélie estime qu'elle ne les méritait pas pour ce simple échange. Apparaît donc cette référence totalement aléatoire à Adam et Ève qui, pour une raison qui m'échappe, aboutira au titre du roman.
Et que penser de ce monologue sur l'amour au neuvième chapitre qui répond à une question existentielle que personne ne se posait : pourquoi Amélie n'a-t-elle encore tué personne ?
Dans l'amour, je vois une ruse de mon instinct pour ne pas assassiner autrui : [...] Et c'est ainsi qu'à ma connaissance, je n'ai pas encore de meurtre à mon actif.(p.77)
Vous vous en fichez ? Moi aussi. Mais pas Mme Nothomb, qui, durant quatre pages assomantes de théories amphigoriques sur le mot koi, force sur la litote pour nous convaincre que ce qu'elle dit a de l'intérêt :
Il n'était pas indifférent que les déclarations de Rinri s'adressant à une francophone s'énoncent soit en français, soit en japonais [...](p.75)
Il n'est pas banal que j'écrive une histoire où personne n'a envie de massacrer personne. Ce doit être cela une histoire de koi.(p.77)
Si l'autrice ressent le besoin d’insister autant sur le caractère soi-disant exceptionnel de ce qu’elle raconte, n'est-ce pas justement le signe que ce qu'elle raconte est en réalité profondément banal ?
[...] une rétrospective de divers bidules. p.41
Ritournelles et antiennes Pour clôre cette réflexion, voici un panorama du stratagème le plus courant dans le livre qui consiste à introduire un mot et à le répéter durant plusieurs pages, le paroxysme étant atteint avec le passage concernant le mot koi :
De tous les éléments cités précédemment, il résulte donc un ouvrage avec une grande hétérogénéité stylistique, où chaque chapitre semble avoir été bâti sur une lubie ou un prétexte différent, avec un procédé, un champ lexical, une émotion qui ne survivent que le temps de ce chapitre. Il s'agit d'un tel patchwork qu'on a parfois l'impression que des auteurs différents ont participé à la rédaction, l'un ayant ébauché une histoire et l'autre ayant meublé les espaces vides.
↑« Hélas, je ne disposerais que de ma parole pour affirmer mon mérite ; nul doute qu'elle ne me vaudrait rien. » p.122
Un troisième prisme d'analyse qui émerge à la lecture, c'est celui de l'exaltation de soi. Griseries égomaniaques, messages vaniteux sous-jacents, bombardements de références littéraires, expressions grandiloquentes : le but du roman semble être de nous rappeler sans cesse à quel point le nombril d'Amélie a une taille gargantuesque.
Le problème c'est que plus Amélie insiste sur le fait qu'elle soit sortie de la cuisse de Jupiter, et moins elle est crédible aux yeux du lecteur. Ce qui impacte en définitive la qualité et la véracité du roman tout entier. Car comment s'identifier à une affabulatrice puérile et antipathique ? Et surtout comment s'attacher à un récit qui a toutes les allures d'un one-woman-show ?
« Mon exploit ne serait jamais qu'un mythe personnel. » p.127
La mégalomanie Amélie nous prévient dès le début du roman :
[...] les toits lourds de tuiles en accolade et l'air immobilisé par le gel me disaient qu'ils m'avaient attendue, que je leur avais manqué, que l'ordre du monde se trouvait restauré par mon retour et que mon règne durerait dix mille ans. J'ai toujours eu le lyrisme mégalomane.(pp.31-32)
Et effectivement, en termes de mégalomanie, nous allons être servis ! Si celle-ci est initialement désamorcée par une pointe d'humour :
Que Tokyo s'abrite de l'onde de choc: on allait voir ce qu'on allait voir. Je me jetai sur le papier vierge avec la conviction que la terre en tremblerait. Curieusement, il n'y eut pas de séisme.(p.62)
Plus on avance dans le livre et plus ce comique de caractère finit par s'essoufler. À l'approche de la centième page, où la moitié d'un chapitre est consacré à l'auto-éloge d'Amélie concernant ses capacités culturelles et linguistiques, le procédé commence à crever les yeux :
Mes progrès en japonais m'épataient [...] personne d'autre qu'un Nippon n'emploierait tournure si aristocratique (p.96)
Il m'arriva maintes fois de parvenir à exprimer dans cette langue des idées si sophistiquées que mon interlocuteur, croyant avoir affaire à une agrégée en nipponologie, me répondait des propos d'une élévation comparable.(p.98)
Par le passé, j'avais appris l'anglais, le néerlandais, l'allemand et l'italien. [...] Par ailleurs, j'ai vécu en Chine, au Bangladesh, etc. Il y a donc, dans mon cas, une véritable exception japonaise que je suis tentée d'expliquer par le destin : c'était un pays où la passivité me serait impensable.(pp.98-99)
J'ai d'ailleurs vécu au Bangladesh(p.107)
On ne dira jamais assez combien je me suis dévouée pour la langue française.(p.105)
Mais le sommet de la suffisance est atteint au chapitre suivant avec l'ascension du mont Fuji et l'épisode de Zarathoustra. Accrochez-vous...
Au-delà de mille cinq cents mètres, je disparais. Mon corps se transforme en pure énergie et le temps qu'on se demande où je suis, mes jambes m'ont emportée si loin que je suis devenu invisible. D'autres ont cette propriété, mais je ne connais personne chez qui ce soit aussi insoupçonnable, car, de près ou de loin, je ne ressemble pas à Zarathoustra. Or, c'est ce que je deviens. Une force surhumaine s'empare de moi et je monte en ligne droite vers le soleil. Ma tête résonne d'hymnes non pas olympiques, mais olympiens. Hercule est mon petit cousin souffreteux. Et encore là, je parle de la branche grecque de la famille. Nous, les mazdéens, c'est quand même autre chose. Être Zarathoustra, c'est avoir à la place des pieds des dieux qui mangent la montagne et la transforment en ciel, c'est avoir à la place des genoux des catapultes dont le reste du corps est le projectile. C'est avoir à la place du ventre un tambour de guerre et à la place du cœur la percussion du triomphe, c'est avoir la tête habitée d'une joie si effrayante qu'il faut une force surhumaine pour la supporter, c'est posséder toutes les puissances du monde pour ce seul motif qu'on les a convoquées et qu'on peut les contenir dans son sang, c'est ne plus toucher terre pour cause de dialogue rapproché avec le soleil. p.117-118
Un culte de soi-même qui continue à parader dans les pages qui suivent :
[Je] passai mon insomnie à grelotter d'idées tellement plus grandes que moi.(p.124)
[...] j'étais un bolide lancé sous le soleil levant, j'étais mon propre sujet d'étude balistique, je hurlais à réveiller le volcan. [...] j'avais battu le record et de beaucoup.(p.127)
« Cher Zarathoustra, bon anniversaire ! » Il s'excusait de ne pas être un surhomme [...](p.128)
Je pense qu'une telle profusion de supériorité est une erreur stylistique qui nuit à l'ensemble du roman. Amélie, en se plaçant constamment au-dessus du reste du monde, s'apparente plus à un archétype qu'à une personne réelle et authentique. Ce manque de vulnérabilité hérige ainsi une barrière vis-à-vis du lecteur qui a du mal à développer un lien émotionnel avec la protagoniste, d'autant plus qu'il y a un décalage flagrant entre cette image de soi démesurée et la réalité.
C'est également un désastre au niveau de la narration, puisque d'une part cet excès de confiance occulte et entrave tout développement psychologique, et d'autre part cela décrédibilise les enjeux du récit en faisant de l'ensemble de la narration une simple mise en scène de la brillance d'Amélie. L'intrigue et les autres personnages ne semblent être que des prétextes aux caprices de l'héroïne et le lecteur se trouve obligé de subir cette célébration de l'égo.
Un roman hyperbolique Cette exubérance d'amour-propre est en outre complétée par des éléments qui participent, volontairement ou non, à cette atmosphère d'autoglorification. Comme une sorte de sous-texte récurrent :
J'avais l'impression d'habiter un lieu d'une importance phénoménale [...](p.54)
[...] fascinée, il se mit à dire vingt fois par jour : « Sacrée Amélie ».(p.86)
Je me préparai à vivre quelque chose d'important(p.89)
Elle s'appelle Juliette et la quitter a été surhumain. Je lui montrai une photo de ma grande sœur sacrée.(p.93)
{..} la nationalité japonaise a toujours une connotation héroïque.(p.115)
[...] à courir dans la lave [...] Un robinet me permit de laver mon visage noirci des projections de lave [...](p.127)
Et tout ce qui se passe dans la vie d'Amélie prend des proportions hors normes, à telle enseigne que l'énormité devient parfois animale :
[...] j'étais amputée par l'absence de Juliette. [...] mais fallait-il que je vive cet arrachement atroce ?(p.94)
Je crus mourir de joie en la retrouvant. Pendant une heure, notre étreinte ne fut que borborygmes animaux.(p.106)
C'est un miracle que j'ai survécu à ce crève-cœur.(p.109)
Je m'enfermai plusieurs heures pour hurler comme une bête.(p.109)
Ensuite, la chambre d'hôtel fut pour moi prétexte à dire bien des phrases extraites du livre de Duras. p.105
Un étalage de culture En ignorant les éléments qui ont effectivement un rapport avec le Japon, comme les auteurs Kaiko Takeshi et Yukio Mishima, Hiroshima mon amour de Marguerite Duras-Duras-Duras-Duras-Duras-Duras-Duras (dans un passage qui dure bien trop longtemps), ou encore la déesse Amaterasu, nous aurons droit à la graphorrhée de références littéraires, historiques ou culturelles suivantes :
La présence de Stendhal me ravit et m'étonna davantage. Je lui dis que c'était l'un de mes dieux.(p.40)
Hakone était la promenade du dimanche des Tokyoïtes lamartiniens.(p.49)
[Je] ne cessais d'arpenter l'appartement en écoutant du Bach(p.54)
Tuvéra, c'était le Cythère de ce garçon(p.63)
La musique de Bach retentit dès que j'ouvris la porte.(p.66)
Schopenhauer voit dans l'amour [...](p. 77)
Il y avait quelque chose de nervalien [...] Nerval au Japon, qui l'eût cru ?(p.93)
[...] les chevaliers de l'ordre du Temple [...] Sous Philippe le Bel [...] Pendant le repars, je tentait de lui raconter Les Rois maudits.(pp.109-111)
Je n'ai pas besoin d'aller à Venise pour comprendre Mort à Venise, ni à Parme pour lire La Chartreuse de Parme (p.100)
Être Zarathoustra [...](p.117)
[...] mazdéo-wagnéro-nietzschéens [...](p.120)
Précisons que ce n'est pas le fait qu'il y ait des références dans le roman qui ennuie. Non, ce qui agace c'est qu'elles ont rarement une raison d'être au sein de l'intrigue, mais semblent plutôt avoir été plaquées là, de manière un peu trop criarde et superficielle.
Dans un pays où la population eût été moins honnête, tant de gens se seraient attribué frauduleusement cette ascension. p.122
Des éléments autobiographiques ? Enfin, un axiome qui nous est râbaché de long en large, c'est qu'Amélie est née au Japon et y a passé son enfance :
Alors, je me mis à lui parler japonais. Je ne l'avais plus pratiqué depuis l'âge de cinq ans [...](p.9)
[...] la région où j'étais née et où j'avais vécu mes cinq premières années : le Kansaï.(p.10)
– Nous allons manger de l'okonomiyaki ! [...] – C'était mon plat préféré quand je vivais dans le Kansaï ! [...] [J']expliquai mon passé japonais avec des trémolos dans la voix.(p.25)
Cette odeur [...] me reporta seize années en arrière à l'époque où ma douce gouvernante Nishio-san me concoctait le même régal [...] J'avais cinq ans, je n'avais jamais quitté les jupes de Nishio-san et je hurlais, le cœur déchiré et les papilles en transe.(pp.27-28)
[...] j'adorais ces glaces pilées arrosées d'un sirop au thé de cérémonie. Je n'en avais plus mangé depuis l'enfance.(p.50)
C'est oublier que j'ai parlé japonais jusqu'à l'âge de cinq ans.(p.99)
[...] retourner sur les lieux de notre enfance. [...] dans le village de Shukugawa.(p.109)
En plus de ces rappels constants à son enfance japonaise, sont ressassés le désir ardent d'être une « vraie » japonaise et le mérite qui s'y rattacherait :
Sans le savoir, j'avais dû parler comme une vraie japonaise [...](p.14)
[...] personne d'autre qu'un Nippon n'emploierait tournure si aristocratique, [...](p.96)
Un train nous conduisit dans le Kansaï. [...] C'est un miracle que j'ai survécu à ce crève-cœur.(pp.108-109)
[...] tout Japonais doit avoir gravi le mont Fuji au moins une fois dans sa vie, faute de quoi il ne mérite pas si prestigieuse nationalité. Moi qui désirais ardemment devenir nippone, [...](p.114)
[...] en vertu d'un conformisme nippon auquel j'avais souscrit, puisque je voulais être japonaise.(p.121)
[...] je méritais d'être nippone, lui méritait d'être belge [...](p.124)
Il mériterait plusoirs fois la nationalité japonaise [...](p.126)
[...] ceux dont je me considérais presque comme la compatriote.(p.128)
Lorsque j'avais réalisé cette analyse pour la première fois, je m'étais demandé pourquoi Amélie, et donc Mme Nothomb (car croyant lire une autobiographie je confondais les deux), insistait tant sur le fait qu'elle avait passé son enfance au Japon. Je trouvais cela curieux, comme si elle essayait de persuader le lecteur de manière un peu trop insistante.
Faisant des recherches à ce sujet sur internet, je suis alors tombé sur ce blog3 et me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas que d'une intuition : Amélie Nothomb, de son vrai nom Fabienne Nothomb, n'est pas née au Japon, mais bien à Etterbeek ! Et lorsqu'on réalise qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie sincère de Mme Nothomb, alors il n'y a aucune raison de faire confiance au reste du récit.
En effet, même si celui-ci semble autobiographique, il n'en reste pas moins que la couverture de l'ouvrage indique « roman4 ». Bien qu'inspiré d'éléments de la vie de Mme Nothomb, il s'agit donc bien d'une œuvre fantaisiste, et ce malgré la confusion entretenue par le roman, notamment avec certains passages qui brisent le quatrième mur :
Il n'est pas banal que j'écrive une histoire où personne n'a envie de massacrer personne.(p.77)
C'est pourquoi il est judicieux de dissocier Amélie le personnage du fiction, de Mme Nothomb l'autrice, le récit n'étant pas une image fidèle de son existence. Ne pouvant identifier les deux, il convient donc prendre des pincettes chaque fois que l'on projette un élément du roman sur l'autrice. En retour, nous pouvons juger directement le style d'écriture et les faits relatés comme étant la responsabilité de la romancière, et non avec l'indulgence que l'on pourrait accorder à un vécu de jeunesse authentique.
↑Maintenant que le pot aux roses a été dévoilé, il est temps de passer en revue d'autres aspects de la personnalité d'Amélie que nous n'avons pas encore abordés frontalement. Ici je m'attache à comprendre les traits de personnalité qui nous sont dépeints à travers ce personnage inventé.
Paradoxes de jugement Comme nous l'avons vu, Amélie nous dit qu'elle hait l'anti-américanisme primaire, mais cela ne l'empêche pas de pester contre les deux américains qui interviennent dans le roman : Quant à moi je haïssais l'anti-américanisme primaire [...]
(p.24). Nous retrouvons ce type de contradiction à plusieurs reprises dans le roman :
De ce vernissage, je tirai un enseignement qui, comme de juste, ne m'a jamais servi [...](p.44)
L'idée me parut bonne en ceci qu'elle avait une signification, mais qu'elle m'indifférait(p.64)
Son prénom me déçut, mais pas le reste de sa personne [...] De connaître sa signification nippone, le prénom cessa de me sembler vilain.(pp.89-91)
La province était toujours aussi belle. Néanmoins, je ne souhaite à personne un tel voyage.(p.108)
J'avais enfin trouvé un endroit d'où il ne me semblait pas magnifique. [...] Impossible de le contempler sans ressentir le picotement mythique sacré : il est trop beau, trop parfait, trop idéal. Sauf à son pied d'où il ressemblait à n'importe quelle montagne, une sorte de boursouflure informe.(pp. 115-116)
La dissonance de ces propos les rend creux, ce qui renforce encore l'impression de vacuité du roman. Amélie parle, mais elle ne dit rien.
La duplicité Un second élément qui caractérise le comportement d'Amélie c'est la tendance au mensonge et à la cachoterie. De manière générale, elle ne rechigne pas à élucubrer des histoires, notamment vis-à-vis de Rinri :
J'en vins à regretter la présence des allemands, sans lequels j'eusse pu alléguer n'importe quoi [...](p.48)
[...] alléguant qu'en Belgique on mangeait la fondue suisse avec du piment rouge.(p.57)
[...] dans mon pays, la tradition exigeait le départ de l'homme à l'aube.(p.61)
Raison de plus pour aller à Hiroshima, inventai-je(p.100)
– Il m'a beaucoup parlé de toi aussi, inventai-je.(p.90)
Cette réponse va selon de moi de pair avec l'orgueil d'Amélie : on ne peut être vrai quand on se camoufle derrière un écran de fumée. Et cela a inévitablement des conséquences sur la relation à l'autre.
L'amour ? La conception et la position d'Amélie par rapport à l'amour est donc fatalement ambivalente. Pour commencer, Amélie ne trouve pas Rinri particulièrement beau. Tout au plus le trouve-t-elle distingué :
Je n'aurais jamais songé à le trouver beau si ma compatriote ne l'avait pas déclaré. D'ailleurs, je n'étais pas persuadée qu'il le fût.(p.22)
Étant particulièrement passive et introvertie, elle ne dit pas ouvertement ce qu'elle pense intérieurement, et est fuyante lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions, ce qui crée un décalage affectif entre elle et Rinri :
Je ne parlais jamais d'amour. Il abordait souvent la question, je m'arrangeais pour changer de conversation.(p.72)
[...] j'eus droit à des mots d'amour hauts comme l'immeuble. Je les écoutai avec courage et me tus.(p.73)
Je l'aimais beaucoup. On ne peut pas dire cela à son amoureux. Dommage.(p.73)
C'est pourquoi je redoutais des déclarations qui eussent exigé une réponse, ou pire, une réciprocité. Mentir en ce registre est un supplice.(p.74)
Au lieu de lui signifier que c'était inavalable, je lui parlais de ma passion [...](p.78)
Enfin, lorsque Amélie parle des raisons pour lesquelles elle apprécie Rinri, celles-ci sont ou purement intellectuelles, ou antinomique à l'amour. C'est-à-dire très éloignées du cœur :
En amour comme en n'importe quoi, l'infrastructure est essentielle.(p.71)
S'éprend-on de ceux pour qui l'on a du goût ? Impensable. On tombe amoureux de ceux que l'on ne supporte pas, de ceux qui représentent un danger insoutenable(p.77)
Nos sœurs respectives nous apparurent dans le bouillon de nos nouilles. Notre liaison avait du sens.(p. 95)
J'étais toujours joyeuse de le voir. J'avais pour lui de l'amitié, de la tendresse. Quand il n'était pas là, il ne me manquait pas.(p.73)
Amélie n'est pas investie dans cette relation. Alors que Rinri est aimant, cultivé et disponible, elle, se contente de recevoir. Sa passivité est selon moi symptomatique d'une image stéréotypée de la femme, et conforme à une logique consumériste. Amélie, déconnectée comme toujours de la réalité, adhère probablement à cet amour de façade car il est commode pour elle d'avoir une relation avec un gentil autochtone. C'est un outil qui lui permet de réaliser son obsession d'être une vraie japonaise.
↑On dirait [...] que j'inventerai tout plein de trucs-machins, des habits rigolos, des ustensiles bizarres, des aliments incroyables et pis, j'en profiterais aussi pour faire un peu de [politique-fiction], pour montrer que je suis une grande ! Oh, ce sera gai ! Et [...] pis en même temps j'en profiterais pour lui réciter tout ce que j'ai retenu de tous les bouquins que j'ai lus. Et j'en ai lus, pfouh ! des tonnes ! Et ça, il faut que tout le monde le comprenne bien ! Ce sera vraiment un super [spectacle], surtout à cause que c'est moi que je fera tout le [spectacle] ! Lu sur un forum
Tout au long de cette analyse, nous avons éclairés le roman Ni d'Ève ni d'Adam sous différents projecteurs. Nous avons vu tour à tour des exemples de l'écriture tantôt provocatrice, tantôt dédaigneuse de Mme Nothomb, ainsi que les différentes astuces par laquelle l'autrice rallonge son roman et rapièce son manque de substance de manière un peu trop ostentatoire. Nous avons aussi évoqué l'hybris de son style, frisant souvent le grotesque. Ce qui se traduit par un personnage, Amélie, constamment centré sur lui-même, ergotant à propos de n'importe quelle vétille, et une intrigue et des personnages lui faisant office de paillassons.
Ma conclusion, c'est qu'il s'agit avant tout d'un livre qui ne doit pas être pris trop au sérieux. Comme nous l'avons constaté il ne s'agit pas d'une autobiographie, mais bien d'une œuvre de fiction, et les nombreuses descriptions tellement gauches qu'elles font grimacer rendent celle-ci dérisoire. Même si j'ai beaucoup forcé le trait dans mes analyses, je suis sûr que Mme Nothomb ne se prenait elle-même pas au sérieux en écrivant ce roman, mais qu'il y a une bonne dose d'ironie et d'auto-dérision dans ces lignes. (Du moins je l'espère sincèrement pour elle...)
Cette conclusion peut sembler étonnante puisque l'épreuve à laquelle je me suis livré ici consistait justement à prendre ce roman au sérieux : traquer les indices disséminés dans le livre et les rassembler afin d'étayer une analyse minutieuse. Le but de cet exercice de longue de haleine était de montrer comment, à partir d'extraits choisis du texte, il est possible d'objectiver certains éléments du récit afin de soutenir différentes thèses et tirer des conclusions sur le style d'un écrivain.
Mon opinion est que Ni d'Ève ni d'Adam est de la mauvaise littérature, et ce à plusieurs égards. Si je dois résumer ce qui me dérange le plus dans son roman, c'est son manque d'épidictique : j'attends d'un bon roman qu'il montre l'exemple à ses lecteurs, qu'il porte des valeurs, qu'il développe des idées intéressantes, vraies, originales, qu'il fasse preuve de maturité émotionnelle, qu'il distingue le beau du laid, bref, qu'il élève l'âme. Or dans ce roman de Mme Nothomb, il me semble que ce soient le médiocre, l'insignifiant, le puéril, la facilité, l'artificiel et le superficiel qui l'emportent.
Mme Nothomb étant née en 1966, cela signifie donc qu'elle a 41 ans au moment où elle écrit ce roman. Et je m'attendrais à nettement plus de conscience, d'expérience et de recul de la part d'une personne de cet âge. Combler le manque de contenu par des disgressions et des gloses ? Décrire un Japon de carte postale ? Inventer des situations invraisemblables ? Dépeindre comme personnage principal quelqu'un qui raconte sa vie, aussi inintéressante soit-elle, tout en gonflant tous les petits détails afin que celle-ci paraisse plus intéressante ? Qui décrit son mépris pour les autres, tout en étant complètement passive dans les faits ? Qui se délecte dans des égotrips ?
En un certain sens, ce Ni d'Ève ni d'Adam prédatait sous le format de la littérature, la surenchère qui s'est emparée des réseaux sociaux : exaltation du soi, mises en scène trompeuses et surenchère d'absurdité.
Pour moi la littérature, ce n'est pas ça. Mais soyons réalistes : rien d'exceptionnel ici. Des écrivains d'achalandage qui ont du succès, il y a en a toujours eu et il y a en aura toujours.
Ce qui est tout de même gênant, c'est que depuis 2015 Amélie Nothomb est membre de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Alors oui, Amélie Nothomb fait vendre, mais en récompensant et mettant en avant ce genre d'écriture, je trouve que l'on donne une bien piètre image de la littérature, nivellant la culture vers le bas, et promouvant un style commercial auprès des plus jeunes. Et que penser de la crédibilité de notre Académie royale après ça ?
Pour terminer sur une note positive, je vais enfiler le chapeau jaune de l'optimistime et concéder que je reconnais au moins un mérite à ce livre : il ne m'a pas laissé indifférent, et il m'aura occupé pendant de nombreuses heures !
↑En bonus, je trouvais intéressant de survoler rapidement quelques aspects de l'adaptation cinématographique de Ni d'Ève ni d'Adam qui font écho à mon analyse du livre.
Premièrement, il est amusant de constater comment le film transpose la caricature du Japon dans le médium du cinéma avec des éléments qui n'existent pas dans le roman. Une scène entière est ainsi dédiée aux gadgets : presse-fruits, machine à café, chocolatière, aspirateur-robot, pêle-pommes, chauffe-pizza, pommeau de bain coloré, masque amincissant et baguettes de massage pour le visage, un appareil bizarre qui se met dans la bouche et dont je questionne encore l'utilité, et même un chien robotique. Et la référence aux Yakuzas apparaît ici via la vidéothèque de Rinri qui est remplie de films du genre (19:50-23:00).
Plus loin, une séquence similaire, toujours dans l'appartement de Rinri : salle avec des samuraïs, estampes japonaises, caméras de surveillance, et surtout un plan particulièrement absurde où un robot déambule dans un couloir après le passage d'Amélie (47:25-49:45).

Deuxièmement, le film surenchérit par rapport au côté kitsch du roman via cet extrait gênant où, après avoir poussé un borborygme animal, Pauline Étienne reprend la chanson J'aime la vie de Sandra Kim. Une horreur musicale et visuelle avec des cœurs incrustés à l'écran... (37:15)

J'aime, j'aime le Japon / Et le drapeau nippon / J'aime, j'aime le Japon / Les sushis, les udons
Troisièmement, même le côté exagéré et presque dégoûtant est repris, ici par exemple avec un passage dramatique en gros plan d'Amélie avec des tentacules de pieuvre vivante en bouche.

En somme, il est amusant de constater que cette adaptation cinématographique, tout en s'écartant du texte écrit, est parvenu à capturer l'esprit du roman jusque dans ses excès.
Dans ce cadre, il est plus particulièrement reproché à l'écrivaine Amélie Nothomb de s'être forgé un passé factice (une enfance au Japon) non dans le seul but de faire mousser son image, mais aussi afin de consolider la version de sa mère qui prétend ne pas avoir été hébergée par ses propres parents avec ses enfants [...]Attention cependant, le paragraphe qui précède est sujet à caution : l'autrice du blog n'est pas neutre dans cette affaire car elle-même est apparentée au mari de cette tante. Recul et esprit critique s'imposent donc, mais je ne résistais pas à l'envie de vous mentionner cette histoire ! ↩ 4. Comme me l'a appris une de mes professeures, Mme Brichart, à l'école secondaire : je venais de lire le Da Vinci Code de Dan Brown, et dans l'édition que je possédais, il était écrit en exergue du texte que tout ce qui allait suivre était « vrai ». Et Mme Brichart de me faire remarquer :
Oui, mais sur la couverture de ton édition il est aussi écrit "roman", ce qui m'avait laissé bien perplexe. ↩